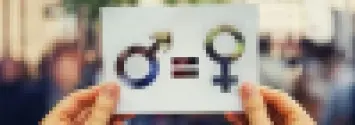Economie circulaire : la dimension citoyenne des entreprises engagées
Économie circulaire, éco-conception des produits et des services, réduction des déchets, protection de l’environnement et des employés. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ouvre la voie à de nouveaux engagements et de nouveaux rôles pour l'entrepreneur et son entreprise. Ce ne sont donc plus les entreprises traditionnelles, vouées à leurs seuls objectifs en chiffres et en zone couverte par leurs commerciaux, qui vont évoluer sur le marché. C'est bel et bien une nouvelle génération d'entrepreneurs ou d'entreprises qui ont décidé de revoir leurs modes de production. Pourquoi un tel revirement ? Avant tout, l'idée de la RSE est d'encourager l'implication volontaire des entreprises dans une démarche d'économie responsable, pour accompagner une transition écologique. Cette stratégie n'est pas uniquement dictée par le seul respect de l'environnement. Elle répond à un nouveau mode de consommation, né du constat commun de produire autrement, pour le bien-être de tous; et aboutit à un développement qui profite autant aux populations présentes que futures. L'idée de traduire cette préoccupation en une politique entrepreneuriale rappelle que si la surconsommation, la surproduction de déchets, le gaspillage, sont des phénomènes liés à la manière globale de consommer. Le secteur privé peut alors devenir une alternative pour inverser progressivement la tendance. L'aspect volontaire de la RSE n'est pas anodin. Pour qu'elle soit le fruit d'une véritable prise de conscience, la RSE doit naître de la volonté commune des membres de l'entreprise à agir autrement. Elle nécessite donc une sensibilisation en interne, une formation des employés, la création de métiers verts ou l'amélioration des postes existants pour remplir les conditions d'une entreprise engagée. En quelques paragraphes, voyons la portée d'une telle révolution entrepreneuriale.
La RSE : une démarche volontaire pour des entreprises engagées
La RSE est une démarche volontaire dans laquelle elle décide de considérer son impact social et environnemental dans la conception, la mise œuvre et la diffusion de ses produits ou l'exécution de ses activités. Cette démarche tient non seulement compte de l'activité entrepreneuriale, mais aussi toutes personnes et organisations qui sont impliquées directement ou indirectement. Les salariés, les actionnaires, les partenaires, les fournisseurs, la communauté environnant, les clients, tous sont concernés. L'intégration de ses préoccupations relève de la conscience de l'entreprise que son rôle n'est plus confiné dans sa seule dimension économique. Celle-ci devient une actrice de la vie sociale, s'engage à réduire son impact climatique et son empreinte écologique, et à son niveau, contribuer à lutter contre le changement climatique. Ainsi, la RSE permet à l'entreprise de mieux comprendre et mesurer la portée sociale et environnementale de ses activités. Sont concernés la consommation d'énergie et d'eau, la sécurité des employés, l'utilisation d'outils polluants, l'approvisionnement en matières premières. Il est par conséquent possible d’agir pour identifier et corriger les impacts sociaux et environnementaux, et sélectionner ou concevoir une stratégie pour diminuer l’empreinte écologique des entreprises. C'est d'ailleurs un engagement qui relève d'un vrai signe du temps, et d'une modification dans la manière de consommer en général. En effet, aujourd'hui, les consommateurs sont de mieux en mieux sensibles à une démarche entrepreneuriale respectueuse de l'environnement et des personnes. Les associations, les syndicats, les collectivités, les actionnaires, les partenaires, les investisseurs etc. font écho à ce nouveau comportement du marché. Dans le futur, l'intensité de ces mobilisations vont contraindre le secteur privé à revoir sa stratégie. Une production nocive au bien-être et à l'environnement ne peut que nuire à la réputation de l'entreprise et à sa pérennité. Ces questions centrales imposent de prendre plusieurs décisions qui peuvent sembler contraignantes, en particulier en matière financière. Elle suppose en effet de revoir tout le dispositif de production, et peut-être financer dans la mobilisation d'outils, des formations et de maîtrise de techniques diverses. En réalité, il est plus logique d'appréhender la RSE en termes d'investissement que de contraintes. Les avantages sont en effet bien importants pour l'entreprise comme ses parties prenantes, telles que les employés, les fournisseurs, la communauté et la société civile, ou encore les consommateurs. Des avantages pour l'entreprise car elle accroît sa performance en tant que secteur productif qu'acteur social. Les risques environnementaux et les problèmes sociaux sont mieux compris, plus professionnellement maîtrisés et surtout bénéficient d'engagements clairs pour les prévenir, les circonscrire et les réduire, en nombre et en intensité. Enfin, et non des moindres, la démarche RSE permet à une entreprise de s'autoréguler, au-delà des exigences déjà posées par la loi. Par exemple, de sa propre initiative, elle participe à la sauvegarde des ressources naturelles en n'étant plus dans une position de surconsommation et de dégradation mais plutôt de valorisation des pratiques positives. Au-delà d'un engagement social, l'impact financier d'une telle démarche n'est pas négligeable : les consommateurs, les investisseurs, les associations, etc. plébiscitent une entreprise responsable et inversement, peuvent boycotter les mauvais élèves.
ISO 26000, la norme qui définit les questions centrales de la RSE
La norme internationale ISO 26000 sur la RSE, publiée en 2010, pose les grandes lignes de la RSE et la rend applicable pour toutes les formes d'organisations, de l'association aux collectivités, en passant par les entreprises. Ainsi, en termes de RSE, la taille de l'entreprise ou sa valeur en chiffres d'affaire ne sont pas forcément des critères pour décider de s'impliquer. Grandes firmes multinationales ou petites et moyennes entreprises, chaque acteur du secteur privé peut avoir sa politique de RSE. L'ISO 26000 n'est pas une norme à vocation certifiable et de la même manière que la RSE, son application est volontaire. Cette norme définit sept secteurs de base qui sont considérés comme les questions centrales de la RSE. La gouvernance, le respect des droits humains, la considération des conditions et relations dans le cadre du travail sont concernés. Il ne faut pas omettre le respect de l'environnement, les bonnes pratiques entrepreneuriales et le respect des lois, les questions en lien avec les consommateurs, et l'engagement sociétal. Ce dernier implique l'entreprise dans le développement local. Ces sept secteurs sont considérés comme étant les questions centrales de la RSE. La bonne gouvernance d'entreprise fait appel aux mécanismes formels et informels d'une organisation. Ce afin de gérer ses affaires d'une manière transparente, responsable et dans le souci des impacts potentiels de ses décisions sur ses parties prenantes et sur l'environnement. Le respect des droits de l’Homme et la considération des conditions et relations de travail suivent cette même logique. Pour une entreprise qui s'engage en RSE, la prise en compte des questions de droits est cruciale, autant pour ses salariés que pour les collectivités riveraines de l'entreprise. Cela peut concerner par exemple la gestion des ressources humaines, la protection sociale des employés, ou bien la mise en place de divers dispositifs de sécurité. Dans ces sept questions cruciales de la RSE, la question environnementale est aussi essentielle : elle est même l'axe principal autour duquel gravitent toutes les actions à entreprendre. Le respect des normes environnementales est appelée à devenir une seconde nature pour les entreprises qui adoptent une politique RSE, en amont, pendant et en aval de ses activités. Enfin, en termes de bonnes pratiques et de respect des lois, l'ISO 26000 préconise que les entreprises se conforment aux dispositions légales dans ses activités qui est une question inéluctable en termes de responsabilité. L'avant-dernière question centrale englobe les questions liées aux consommateurs. C'est une démarche capitale à laquelle les entreprises doivent consacrer un temps de réflexion. Il s'agit, pour résumer, de répondre aux questionnements légitimes des consommateurs : confidentialité des informations personnelles, traçabilité des produits, respect des normes de santé etc. Enfin, l'ISO 26000 valorise le développement local comme engagement responsable. Cela repositionne la finalité de l'entreprise, au-delà de ses seuls bénéfices financiers et exigences de rentabilité, en l’étendant à la manière dont ses activités peuvent positivement soutenir ou changer la communauté.
L'économie circulaire : une bonne pratique de la RSE
Le concept de l'économie circulaire est l'une des bonnes pratiques issues de la RSE et une des réponses des questions centrales de la norme ISO 26000. L'économie circulaire consiste à concevoir, produire et diffuser des produits ou des services. En prenant soin d'avoir une consommation rationnelle des ressources naturelles comme l'eau, l'énergie, le bois, avec le moins de déchets et de gaspillages possible. L'économie circulaire s'articule autour de six priorités. Le premier critère est la démarche d’éco-conception, qui est le pivot de l'économie circulaire. A travers cette technique, il est possible de réduire son impact sur l'environnement, et ce durant tout l'ensemble du cycle de vie des produits en entreprise. Le second critère qu'est l'approvisionnement durable se construit sur une stratégie d'achats responsables. Par exemple, l'entreprise choisit de sélectionner des fournisseurs selon des conditions de respect environnementales et de bonnes pratiques des affaires. Elle peut aussi choisir ses partenaires en fonction de la possibilité d'évoluer avec ces derniers dans l'atteinte d'un objectif environnemental. Le troisième critère est la synergie industrielle des entreprises localisées dans une même zone. Il peut être intéressant de collaborer pour réduire leurs déchets en entreprise à l’aide des organisations situées à proximité. Il sera alors possible de moins polluer, en réutilisant les résidus des activités des uns et des autres, ou en maximisant les services disponibles pour moins de gaspillages. Le quatrième pré-requis est l'économie de fonctionnalité. Elle favorise l'usage des produits plutôt que l'achat : l'entreprise se mobilise plutôt sur les services liés au produit ou à la prestation afin de limiter son empreinte écologique. L'économie de fonctionnalité réduit considérablement la pollution industrielle née de l'obsolescence programmée des divers outils et privilégie une économie plus collaborative. Par exemple, au lieu de vendre une imprimante, une entreprise spécialisée dans le secteur crée la possibilité de facturer à l'impression. La cinquième condition de l'économie circulaire est la consommation responsable. Il s’agit d’une consommation raisonnée, dans laquelle le choix d'un produit ou d'un service est conditionné par des critères environnementaux et sociaux. Les exemples les plus fréquents sont la non-utilisation de pesticides ou l'absence d'enfants impliqués dans le travail de l'entreprise. La sixième priorité de l'économie circulaire est l'allongement de la durée de vie d'un produit. Pour aboutir sur la démocratisation du recyclage, notamment de l’emballage éco-conçu ou de l’emballage recyclable en entreprise. Un produit peut être réutilisé via le recyclage ou réemployé à travers une donation ou une revente. Cela permet d'allonger considérablement sa durée de vie sans gaspiller, ni produire un déchet. En quelques mots, le principe de l'économie circulaire évite une surconsommation des ressources naturelles à toutes les étapes de vie d'un produit ou d'un service. Ces ressources seront optimisées lors de la conception, la création, le test et le circuit de validation, la distribution sur le marché et à l’accès des clients. Jusqu’à l’usage du produit et la récupération/transformation du produit en fin de vie. C'est une démarche qui s'inscrit dans la politique RSE de l'entreprise et qui interpelle sur la nécessité de repenser le mode de production et de consommation en général. L'idée d'économie circulaire est en effet l'alternative à un modèle économique linéaire qui se traduit par l'épuisement des ressources naturelles en amont et l'accumulation de déchets en aval. Contrairement à l'économie linéaire, l'économie circulaire réintègre les produits en fin de consommation par différentes formes de recyclage : valorisation des déchets ménagers, transformation des contenants, récupération de divers matériaux, etc.
En conclusion, la RSE et l'économie circulaire sont des alternatives primordiales pour une économie plus saine, dans un contexte environnemental et social. Cette dimension de bien-être commun est difficilement évaluable, mais l'on sait qu'elle pérennise l'entreprise autant dans sa démarche économique que sociale. Bien plus qu'une unité de production, elle devient un centre névralgique de la vie de la communauté et rejoint les préoccupations légitimes des populations et des consommateurs. L'autorégulation est une valeur ajoutée dans la réputation de l'entreprise car elle traduit une prise de responsabilité volontaire, consciente et autonome. Le poids de la RSE sur le capital immatériel d'une entreprise ne cesse d'augmenter. Selon les études réalisées en 2017, 43% des Français sont soucieux de la réputation sociale et politique des marques. Ainsi, la qualité des produits et des prestations ne sont plus les seuls curseurs employés par les consommateurs : la dimension citoyenne de l'entreprise devient une exigence.