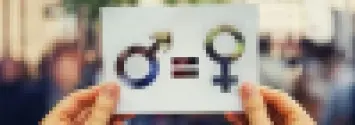Certaines activités de sociétés industrielles engendrent des émissions de substances toxiques et/ou polluantes comme les composés organiques volatils (COV). Ces derniers sont particulièrement dangereux pour l’environnement et pour les personnes qui sont exposées. De ce fait, la réduction des émissions de COV représente un enjeu important pour les entreprises. La protection de l’environnement, ainsi que de la santé du personnel des entreprises industrielles dépendent des mesures adoptées.
Les entreprises les plus concernées par les risques associés aux COV sont les industries dans les secteurs comme la mécanique, la construction automobile, le BTP, la chimie, la pharmacie, le textile, l’imprimerie, la métallurgie, l’agroalimentaire, etc.
Afin de limiter les risques dans les entreprises, quelques mesures de précaution peuvent être adoptées. Avant de manipuler des produits contenant des COV, il est vital de réunir un maximum d’informations sur les objets en question. Il est conseillé de consulter le mode d’emploi et les fiches techniques offerts par le fabricant. Il est également possible de se référer aux documents proposés par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). Par exemple, des fiches de données de sécurité (FDS), fiches toxicologiques (FT)... L’employeur a l’obligation d’adopter des mesures de précaution adaptées pour assurer la sécurité et le bien-être au travail.
Composés organiques volatils : de quoi s’agit-il ?
La famille des composés organiques volatils rassemble des substances d’origine anthropique ou biogénique se caractérisant par leur aspect volatil. Les COV apparaissent sous forme de gaz ou de vapeurs contenant du carbone. Leur facilité à se répandre dans l’atmosphère fait qu’ils peuvent très rapidement polluer l’air dans un bâtiment industriel, dans une habitation ou au niveau des lieux publics. On parle parfois de COVNM pour distinguer les composés organiques volatils non méthaniques.
La directive européenne du 11 mars 1999 concernant l’objectif de diminution des émissions de COV engendrées par l’usage de solvants organiques dans certaines installations et pour des activités diverses précise la différence entre un composé organique et un COV.
D’après ce texte réglementaire, les termes « composés organiques » sont utilisés pour désigner n’importe quel composé dont la composition comprend le carbone et au moins un des éléments ci-après : azote, halogène, hydrogène, oxygène, phosphore, silicium, soufre. Cependant, les oxydes de carbone, les bicarbonates inorganiques ainsi que les carbonates sont considérés comme des exceptions.
Selon la directive, lorsqu’à une température de 293,15 K ou dans des conditions d’utilisation particulières, la pression de vapeur d’un composé organique est l’équivalent ou supérieure à 0,01 KPa, celui-ci est classé dans la classe des COV.
L’émission de composants organiques a souvent lieu lors de l’évaporation du carburant ou du solvants présents dans les peintures, lors des phénomènes de combustion ou en présence de quelques réactions biologiques. Dans certains procédés, les COV sont utilisés comme dégraissant, agent de nettoyage ou de synthèse, solvant, dissolvant, conservateur, disperseur et d'autres encore.
Il existe plusieurs sortes de COV. Il y a, par exemple :
- le benzène que l’on retrouve dans les solvants, encres et peintures ;
- le toluène, contenu dans de nombreux produits de vitrification, dans les colles, vernis, solvants et peintures ;
- le trichloréthane, aussi rencontré dans les diluants ;
- le formaldéhyde, un composant des colles et des adhésifs, les peintures, les enduits...
Dans la liste des COV les plus connus, il y a également l’acétone, l’éthanol et le butane.
Les émissions de COV peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé des êtres vivants et sur la planète. Les impacts des composés organiques volatils varient en fonction de leur type, du niveau d’exposition ou du volume d’air inhalé ainsi que de l’état de santé de la personne exposée. Ces polluants peuvent engendrer différentes formes d’irritations au niveau du nez, des yeux ou de la gorge. Ils peuvent notamment provoquer une gêne olfactive, des sensations d’inconfort thoracique, des toux, des troubles du système nerveux, troubles digestifs, ou des troubles cardiaques. Parfois, la capacité respiratoire de la personne touchée se trouve diminuée.
Certains composés organiques volatils, comme le benzène, peuvent avoir de graves conséquences sur l’organisme d’un individu. Ils sont alors indexés dans une catégorie particulière : CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique). Dans le code de travail, il existe des lois strictes sur ces COV. L’exposition d’employés à ces substances toxiques est interdite.
La pollution industrielle, un impact direct sur le climat
Les composés organiques volatils émis dans l’atmosphère ont des conséquences néfastes sur l’environnement. En effet, en se dégradant, ils provoquent de nombreuses réactions et perturbent les équilibres chimiques. Ils favorisent l’accumulation d’ozone (troposphère). Les émissions de COV constituent une forme de pollution industrielle source de la dégradation de la santé des végétaux, des animaux et des hommes.
Les COV et les gaz à effet de serre sont responsables de la formation d’ozone troposphérique et contribuent ainsi au réchauffement de la planète. Ils sont une cause des fontes de glace et de la hausse du niveau de la mer. En outre, il existe des catégories de COV qui favorisent le phénomène des pluies acides.
En 2012, environ 524 000 décès prématurés ont eu pour cause la pollution atmosphérique : particules fines, ozone, dioxyde d’azote et autres polluants. En plus des impacts directs de la pollution sur les êtres vivants, les effets sur le climat ne peuvent être négligés. En effet, ces conséquences sont des facteurs qui augmentent le taux de mortalité dans différents pays.
Les canicules, par exemple, provoquent la déshydratation chez les individus en âge avancé. Cela mène souvent vers un haut risque d’hypotension artérielle, à la réduction du flux coronaire et enfin vers une possibilité d’accident coronaire aigu. Mis à part les canicules, les tempêtes, les ouragans, les sécheresses ou les inondations font partie des conséquences du réchauffement climatique favorisé par la pollution industrielle. Ce n’est que vers la fin du 20e siècle que les prises de conscience et les recherches de solutions pour limiter l’impact environnemental aux entreprises et aux particuliers se sont multipliées. Mis à part les sociétés industrielles, il existe des domaines variés qui génèrent de la pollution. Par exemple, citer les transports, l’énergie (production et distribution), le transport ainsi que l’urbanisation ; même si aujourd’hui, dans chaque secteur, des solutions permettant de limiter, voire éviter la pollution, apparaissent.
La pollution industrielle apparaît sous plusieurs formes. La production d’énergie par des procédés nécessitant l’abattage des arbres et le fait de brûler des substances fossiles provoquent la hausse du taux de dioxyde de carbone et d'autres GES (gaz à effet de serre) libéré dans l’atmosphère.
Selon un rapport publié en 2017 sur une étude réalisée par Carbon Disclosure Project et Climate Accountability, 71 % des émissions industrielles de gaz à effet de serre depuis l’année 1988 sont produits par seulement 100 entreprises. Ces dernières sont constituées des firmes productrices de pétrole, gaz et charbon. D’après les publications d’organismes de recherche spécialistes de l’impact climatique, 10 % de la quantité de polluants générés sont associés directement aux activités d’extraction. Les andis que 90 % sont générés indirectement par les produits obtenus à partir des énergies fossiles et émetteurs de GES. Aujourd’hui, tous les pays se fixent des objectifs pour promouvoir une stratégie de développement pouvant assurer la croissance économique sans des conséquences nuisibles à l’environnement. On parle souvent de développement durable et de RSE.
Quels dispositifs pour contrôler la pollution industrielle ?
Depuis quelques dizaines d’années, des textes législatifs, dont des arrêtés municipaux, des directives et des protocoles encadrent les émissions de COV. Sur le plan international, on note particulièrement l’existence du protocole de Genève (1991). Celui-ci vise à réduire la pollution atmosphérique causée par certains polluants et les flux transfrontières associés. Il est question de limiter les émissions de polluants engendrées par des produits utilisés dans les industries et les ménages. Le protocole concerne également les oxydants photochimiques secondaires qui accompagnent les polluants.
Il y a également le protocole de Göteborg (1999), dont l’objectif est de réduire l’acidification, l’eutrophisation et l’ozone troposphérique. Il est aussi appelé « multipolluant/multi-effet ». De nombreux polluants sont concernés : ammoniac, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, etc. Le dispositif existe également pour limiter la pollution industrielle créée par les COV et les NOx. Suite à l’effet de ces derniers, de l’ozone s’accumule dans la basse atmosphère. Le protocole de Göteborg tient compte des conséquences de la pollution industrielle sur la santé et l’environnement.
Des règlements spécifiques sous forme de directives sont également en place sur le territoire européen. Il y a, par exemple, la directive 1996/61/CE ou Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Celle-ci oblige les entreprises à tenir compte des documents sectoriels ou transversaux (BREF) et à adopter les meilleures techniques disponibles (MTD). Cette directive touche particulièrement les installations industrielles avec un potentiel de pollution élevé.
3 années plus tard, la directive 1999/13/CE sur la réduction d’émissions COV en entreprise est mise en place. Elle encadre les entreprises dont les installations et les activités requièrent l’usage de solvants organiques. Cette directive a donné naissance à différentes notions comme les VLE (valeurs limites d’émissions totales, canalisées et diffuses), le PGS (plan de gestion des solvants), le SME (Schéma de maîtrise des émissions). Le 24 novembre 2010, la directive 2010/75/UE ou IED (Industrial Emission Directive) est venue remplacer les directives 1996/61/CE et 1999/13/CE après l’abrogation de celles-ci.
En France, des plafonds d’émission nationaux de COV et autres polluants atmosphériques sont fixés par la directive 2001/81/CE. Celle-ci, aussi appelée NEC ou National Emission Ceilings, a été adoptée le 23 octobre 2001. En vue de limiter la pollution industrielle, les entreprises ont plusieurs possibilités en termes de démarches. Les solutions dépendent de chaque site industriel et des activités qui s’y déroulent. La sélection des démarches doit se faire en considérant des informations précises sur le caractère et la quantité des sources d’émissions de COV.
Dans le cadre de leur souhait d’évaluer leurs émissions de COV, les industries peuvent avoir recours à des organismes spécialisés tels que des laboratoires agréés ou des centres techniques. En effet, l’aide d’un professionnel permet de connaître et de respecter les législations en vigueur, identifier les produits pouvant émettre des COV et de calculer la quantité des substances rejetées, évaluer les émissions diffuses et canalisées de COV. Après un contrôle sur l’existant, les experts fournissent les meilleurs conseils et accompagnements pour la mise en œuvre des solutions techniques adéquates pour la réduction des émissions de composés organiques volatils.
Lorsqu’il s’avère impossible de remplacer les produits contenant des COV, il est important de choisir des traitements adaptés pour limiter les risques d’émissions nuisibles à l’environnement. Dans ce sens, il existe deux solutions : le recours à des procédés destructifs (oxydation thermique ou catalytique, traitement biologique) et les procédés récupératifs (condensation, adsorption, séparation sur membrane ou absorption).
Compte tenu de l’état des lieux actuel sur la pollution atmosphérique ainsi que les risques sur la santé et sur l’environnement, il devient urgent pour toute la population, surtout les industries les plus pollueuses de trouver des solutions adaptées. Des actions de lutte contre la pollution aux COV sont à intégrer dans les stratégies globales de RSE, au même titre que la réduction de l’empreinte écologique de l’entreprise, ou qu’une réflexion autour de l’économie circulaire.
Pour la France, lorsque le protocole de Göteborg a été révisé en 2012, l’objectif de réduire de 43 % les émissions de COVNM entre 2005 et 2020 a été fixé. Ensuite, il faut aussi noter qu’avec la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 sur la réduction des émissions nationales de polluants atmosphériques, l’objectif est de réduire de 52 % les émissions de COVNM de 2005 pour l’horizon 2030. Pour l’atteinte des objectifs, le traitement à la source est à favoriser, c'est-à-dire le fait de réduire la quantité de solvants utilisés ou utiliser des procédés évitant l’incinération de ceux-ci. En effet, en absence d’incinération, il n’y a aucune émission de CO2.
Certaines entreprises ont pu substituer aux peintures à teneur élevée en solvant à des peintures en phase aqueuse. Dans d’autres sociétés industrielles, le traitement en aval est possible. Elles ont alors mis en place des appareils permettant de capter des vapeurs de solvant au moment des opérations de nettoyage. Les organismes comme l’ADEME ont publié des guides sur les différentes solutions permettant de maîtriser les émissions de COV et autres polluants. En fonction des spécificités de leurs activités, les entreprises peuvent alors plus aisément trouver de bons supports pour la recherche des solutions les mieux adaptées. En effectuant des achats responsables, chaque citoyen peut apporter sa contribution dans la réussite des actions de lutte contre la pollution aux COV.